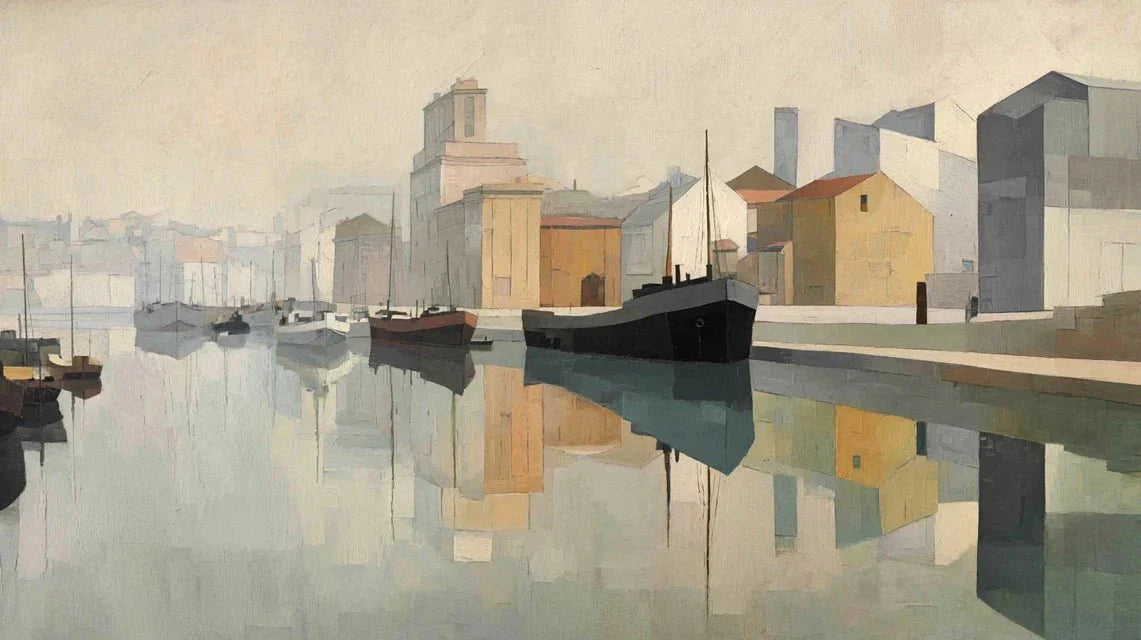En 1893, Armand Guillaumin débarque dans la vallée de la Creuse avec un trésor dans la poche : 100 000 francs gagnés à la loterie (Source : Musée d'Orsay). Fini le travail de nuit aux Ponts et Chaussées ! Le voilà libre de pratiquer la peinture en plein air à temps plein. Et c'est justement ici, dans ce coin reculé du centre de la France, qu'il va trouver son eldorado artistique propre à l'impressionnisme français.
Les rives tourmentées de la Creuse, ces falaises qui plongent dans l'eau sombre, ces gorges profondes... Tout le fascine. Monet est passé par là quatre ans plus tôt et a détesté le climat capricieux. Guillaumin, lui, se sent chez lui. Cette nature rude correspond à son tempérament de coloriste.
Les paysages de Guillaumin dans la vallée de la Creuse
Entre 1893 et 1920, Guillaumin peint plus de cent toiles de la Creuse (Source : Galerie Durand-Ruel). Son atelier ? Les berges de Crozant, là où la Creuse rencontre la Sédelle. Il s'installe face aux ruines du vieux château fort, chevalet planté dans l'herbe, et commence à capturer ces vallées encaissées avec sa touche divisée caractéristique.
Son site préféré s'appelle les Grandes Gouttes. Il le peint en boucle : blanc glacé l'hiver, orange éclatant en mars, gris mélancolique à l'automne. Le même endroit, mille ambiances différentes. C'est sa façon de dire "je connais ce lieu par cœur".
Ses toiles racontent :
- Les méandres sinueux bordés de rochers titanesques
- Les matins d'hiver où la gelée blanche craque sous les pas
- Les printemps vaporeux où les formes se dissolvent
- Les perspectives qui rappellent les estampes japonaises
La couleur pure comme signature des paysages de Guillaumin
"Coloriste furieux" : c'est ainsi que le critique Félix Fénéon le décrit en 1886 (Source : Wikipedia). Le qualificatif colle à la peau de Guillaumin toute sa vie. Dans la Creuse, il pousse la couleur encore plus loin. Sa palette chromatique s'emballe, s'éloigne du réel pour entrer dans une logique post-impressionniste. Tant pis pour la vraisemblance, ce qui compte c'est l'impact émotionnel.
Prenez ses paysages de neige exposés chez Durand-Ruel en 1894 : même la blancheur de l'hiver explose de couleurs intenses. Vincent van Gogh est fan. Il parle de Guillaumin dans au moins 36 lettres entre 1888 et 1890 (Source : Wikipedia). Pour Van Gogh, ce gars-là comprend quelque chose d'essentiel à la nature.
Techniques de couleur pure appliquées aux paysages creusois
Guillaumin ne mélange presque jamais ses couleurs sur la palette. Il les pose pures, directement sur la toile. Un bleu à côté d'un orange. Un violet contre un jaune. C'est l'œil qui fait le mixage. Envie de voir comment cette approche inspire l'art contemporain ? Explorez les tableaux paysages modernes.
Sa méthode creusoise repose sur quatre piliers :
- Des couleurs complémentaires qui vibrent côte à côte
- Une pâte épaisse, presque sculptée (Monet travaillait plus fin)
- Des coups de pinceau francs, sans hésitation
- Zéro noir : les ombres sont violettes, bleues, vertes
Son "Paysage de neige à Crozant" (vers 1895, MuMa du Havre) illustre parfaitement sa technique. On devrait grelotter devant cette scène hivernale. Au lieu de ça, on est ébloui : bleus électriques, roses tendres, violets profonds, jaunes solaires. Tout chante ensemble.
Les paysages de la Creuse : motifs récurrents chez Guillaumin
Guillaumin développe un répertoire de motifs creusois qu'il revisite sans cesse, participant activement au rayonnement de l'École de Crozant. Le moulin Barrat au bord de l'eau. Les rochers de la Sédelle qui émergent comme des sculptures géantes. Le panorama depuis les ruines du château. Il connaît chaque pierre, chaque tournant de la rivière.
Ce qu'il cherche à capter ? Ces moments magiques où la lumière transforme tout. Le matin d'hiver quand le givre fait scintiller les paysages rocailleux couverts de bruyère. L'après-midi d'automne quand les couleurs s'embrasent. Cette vallée a un côté sauvage, presque agressif. Guillaumin l'adore.
Il devient le chef de file de l'École de Crozant. D'autres peintres débarquent : Léon Detroy, Émile-Othon Friesz, Clémentine Ballot (sa seule élève, qui le rejoint en 1912). Tous tombent sous le charme des vallées creusoise et adoptent cette approche de peinture en plein air.
L'intensité chromatique des paysages de Guillaumin à Crozant
En 1895, Guillaumin peint déjà comme un fauve. Dix ans avant que le fauvisme existe officiellement ! Ses roches rouges d'Agay annoncent la couleur (littéralement). Mais c'est dans les paysages de Crozant que son audace chromatique atteint des sommets.
Aujourd'hui, le Musée d'Orsay possède 48 de ses œuvres, le Petit Palais 91 (Source : Wikipedia). Beaucoup représentent la Creuse. Ces toiles racontent l'évolution d'un peintre qui n'a jamais eu peur de pousser la couleur dans ses retranchements. Les collectionneurs suisses Oscar Ghez et Gérard Corboud ont compris sa valeur et accumulé des dizaines de ses paysages creusois.
Puis arrive 1917. On commence à construire le barrage d'Éguzon. Six ans de travaux qui vont noyer une partie des paysages que Guillaumin aime tant. Pour lui, c'est un crève-cœur. Ce paysage sauvage qu'il a peint pendant près de trente ans disparaît sous les eaux. Il se détourne progressivement de Crozant, part vers Agay sur la Méditerranée. Mais il emporte avec lui sa technique de couleur pure, forgée dans les vallées de la Creuse.
FAQ : Tout savoir sur les paysages de Guillaumin
Pourquoi Guillaumin a-t-il choisi la vallée de la Creuse ?
Guillaumin découvre la Creuse en 1893 après avoir gagné à la loterie. Cette vallée sauvage aux paysages tourmentés correspond parfaitement à son tempérament de coloriste audacieux. Contrairement à Monet qui trouve le climat difficile, Guillaumin s'épanouit dans cette nature rude et produit plus de cent toiles de la région entre 1893 et 1920.
Qu'est-ce que la technique de couleur pure chez Guillaumin ?
La couleur pure désigne la méthode de Guillaumin consistant à appliquer les pigments directement sur la toile, sans mélange préalable sur la palette. Il juxtapose des couleurs complémentaires (bleu/orange, violet/jaune) et laisse l'œil du spectateur créer les nuances. Cette technique, qualifiée de "furieuse" par les critiques, annonce le fauvisme dès 1895.
Où peut-on voir les paysages creusois de Guillaumin aujourd'hui ?
Les principales collections se trouvent au Musée d'Orsay (48 œuvres) et au Petit Palais à Paris (91 œuvres). Le MuMa du Havre conserve également "Paysage de neige à Crozant". De nombreux musées internationaux possèdent ses toiles, notamment l'Art Institute of Chicago et le Metropolitan Museum de New York.